S’imaginer AUTOCHTONE en lisant.
ÉPISODE 4 : Canada
PAYER LA TERRE, un album de Joe Sacco

En 2015, Joe Sacco s’est rendu par deux fois dans les territoires du Nord-Ouest du Canada, au-dessous de l’Arctique. Il est allé à la rencontre des Denes, un peuple autochtone. L’auteur nous raconte l’histoire de ce peuple, ses traditions, restées intactes pour certaines, les premières rencontres avec les Anglais.
Pendant longtemps, les peuples indigènes du Grand Nord, vivant sur des terres non propices à la colonisation agricole, restèrent livrés à eux-mêmes, jusqu’à ce que la découverte de pétrole et d’or incite le gouvernement à officialiser son autorité sur eux, comme sur leurs terres. À cette période, les autorités s’appropriaient les territoires, non plus par les massacres, mais cliniquement, méthodiquement, et de façon administrative – grâce à des traités.
En lisant ceux-ci, on n’échappe pas à l’impression que les «Indiens» ont donné la terre où ils vivaient en échange de la promesse d’une annuité de quelques dollars, de quelques outils et de médailles pour ceux qui se disaient leurs chefs. Aujourd’hui, la fracturation hydraulique ajoute la pollution à la spoliation initiale.
UNE SAISON DE CHASE EN ALASKA, de Zoé Lamazou et Victor Gurrey

Une journaliste et un dessinateur partent pour trois mois à l’extrême nord de l’Alaska, en immersion auprès des derniers chasseurs de baleines.
Ils veulent constater sur le terrain la révolution qui s’opère dans cette région polaire où la vie traditionnelle résiste encore tant bien que mal. Un nouvel eldorado pétrolier très convoité, des autoroutes maritimes bientôt accessibles, des ports gigantesques : comment les Iñupik, occupants millénaires de ces terres arctiques, envisagent-ils l’avenir qui leur est imposé ?
Zoé Lamazou et Victor Gurrey ont partagé le quotidien des habitants de Point Hope durant une saison de chasse. Ils nous livrent des témoignages émouvants sur un monde en mutation, menacé.
La TRILOGIE de Michel Jean



Autochtone innu de Mashteuiatsh, sur les rives de Pekuakami, le lac Saint-Jean, au Québec, Michel Jean est écrivain et journaliste. Il a d’abord écrit KUKUM, l’histoire de son arrière-grand-mère, Almanda, sa kukum, qui, orpheline, élevée par des fermiers, quitte les siens, par amour pour un jeune chasseur innu, Thomas, et rejoint le clan des Atuk-Siméon dont elle partagera le quotidien en forêt. ATUK raconte l’histoire de sa grand-mère, la fille d’Almanda, MAIKAN celle des pensionnats. En 1936, sur ordre du gouvernement canadien, tous les jeunes Innus de Mashteuiatsh sont arrachés à leurs parents pour être envoyés au Nord dans un pensionnat tenu par des missionnaires catholiques.
Trois très beaux livres, parfois durs, toujours emprunts de poésie et du courage des Innus, notamment des femmes.
CINQ PETITS INDIENS, de Michelle Good

Michelle Good est une auteure crie appartenant à la nation Red Pheasant. Elle a travaillé comme avocate auprès des survivants des pensionnats pendant plus de vingt ans. Dans son livre sorti en 2023, elle décrit l’existence, dans les années 1960, dans un quartier pauvre de Vancouver, de cinq de ces survivants qui essaient comme ils peuvent de dépasser leur immense traumatisme.
MANIKANETISH, de Naomi Fontaine

Naomi Fontaine, née en 1987 dans la communauté innue, est à la fois romancière et enseignante. Son livre raconte, par la voix d’une enseignante de français, la vie, sur une réserve innue de la Côte-Nord, de jeunes qui cherchent à se prendre en main.
LE PEUPLE RIEUR, de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque

Chronique de la vie du peuple innu par un anthropologue canadien. Ce récit commence dans la nuit des temps et se poursuit à travers les siècles, jusqu’aux luttes politiques et culturelles d’aujourd’hui.
JEU BLANC (traduction de INDIAN HORSE), de Richard Wagamese

Saul Indian Horse, indien ojibwé, raconte son histoire : son enfance ojibwée avec sa grand-mère, son exil obligatoire dans un pensionnat, sa carrière de hockeyeur sur glace surdoué, freinée par le racisme qui règne dans les années 1970 au Canada, y compris au sein du sport national.
Ce roman est écrit par un auteur lui-même ojibwé.
NITASSINAN, de Julien Gravelle

Neuf destins, cinq siècles d’histoire : le roman d’une terre, le Nitassinan (en jaune et rouge sur cette carte), la terre des Innus.

Les Innus habitent le Nitassinan depuis 8 000 ans. Depuis 400 ans, des européens venus en colons occupent le territoire, surtout pour l’exploitation des ressources naturelles. Les Innus se répartissent en 12 communautés, dix au Québec et deux au Labrador.
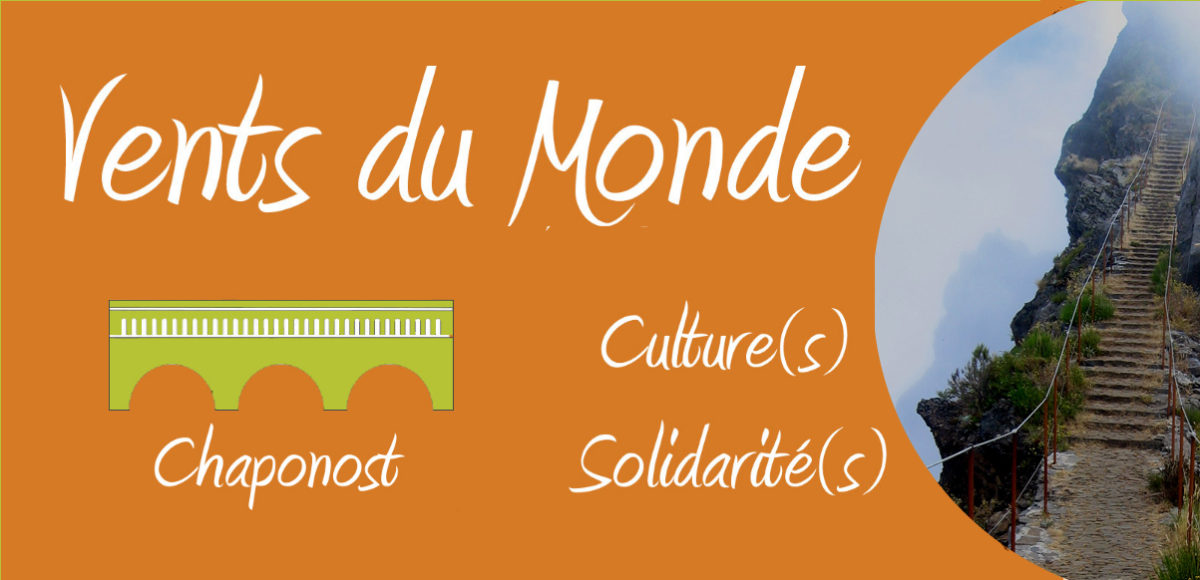





 Ce totem est retrouvé dans ce musée en 1991. Malgré d’intenses efforts, les Haisla ne réussissent pas dans un premier temps à rapatrier leur totem.
Ce totem est retrouvé dans ce musée en 1991. Malgré d’intenses efforts, les Haisla ne réussissent pas dans un premier temps à rapatrier leur totem. Ce film est l’une des œuvres les plus influentes et les plus diffusées à être issues de l’Indian Film Crew. Il relate la manifestation, en 1969, des Kanien’kéhaka d’Akwesasne, un territoire qui chevauche la frontière canado-américaine. Lorsque les autorités canadiennes décident de leur imposer des taxes sur leurs achats effectués aux États-Unis – contrairement à ce qui avait été établi par le traité Jay de 1794 –, les Kanien’kéhaka bloquent le pont international entre l’Ontario et l’État de New York. Vous êtes en terre indienne a été montré à travers le continent, aidant à mobiliser une nouvelle vague de militants autochtones.
Ce film est l’une des œuvres les plus influentes et les plus diffusées à être issues de l’Indian Film Crew. Il relate la manifestation, en 1969, des Kanien’kéhaka d’Akwesasne, un territoire qui chevauche la frontière canado-américaine. Lorsque les autorités canadiennes décident de leur imposer des taxes sur leurs achats effectués aux États-Unis – contrairement à ce qui avait été établi par le traité Jay de 1794 –, les Kanien’kéhaka bloquent le pont international entre l’Ontario et l’État de New York. Vous êtes en terre indienne a été montré à travers le continent, aidant à mobiliser une nouvelle vague de militants autochtones. Documentaire de 1998 d’une densité poétique et personnelle sur la nation huronne-wendat. René Siouï Labelle retrace l’itinéraire de ses ancêtres. Il arpente le territoire, recueille des images. Le passé méconnu émerge de ces rencontres avec des femmes et des hommes inspirés. La plupart sont originaires de Wendake, situé à huit kilomètres au nord-ouest de la ville de Stadaconé, jadis décrite par le chef Donnacona comme le grand village, ou « Kanata », lors d’une rencontre avec Jacques Cartier. Y seront évoqués le rapport entre l’être humain et son environnement, la reconnaissance et la transmission du patrimoine, la défense des droits des Amérindiens, et une spiritualité unique fondée sur la diplomatie et le respect.
Documentaire de 1998 d’une densité poétique et personnelle sur la nation huronne-wendat. René Siouï Labelle retrace l’itinéraire de ses ancêtres. Il arpente le territoire, recueille des images. Le passé méconnu émerge de ces rencontres avec des femmes et des hommes inspirés. La plupart sont originaires de Wendake, situé à huit kilomètres au nord-ouest de la ville de Stadaconé, jadis décrite par le chef Donnacona comme le grand village, ou « Kanata », lors d’une rencontre avec Jacques Cartier. Y seront évoqués le rapport entre l’être humain et son environnement, la reconnaissance et la transmission du patrimoine, la défense des droits des Amérindiens, et une spiritualité unique fondée sur la diplomatie et le respect. Ce court-métrage documentaire de 2015 nous amène au coeur d’un véritable pow-wow traditionnel. En suivant le parcours de Tony Chachai, jeune autochtone en quête d’identité, la cinéaste originaire de Manawan se penche sur la culture, le passé et la transmission du savoir et des connaissances au sein des membres d’une communauté atikamekw. Mu par le désir de renouer avec sa famille et ses racines, Tony Chachai livre un témoignage touchant sur le chemin qui l’a ramené auprès des siens. À l’aube de devenir père, il prend conscience de la richesse de cet héritage et célèbre ce passé en dansant dans un pow-wow aux côtés de son cousin.
Ce court-métrage documentaire de 2015 nous amène au coeur d’un véritable pow-wow traditionnel. En suivant le parcours de Tony Chachai, jeune autochtone en quête d’identité, la cinéaste originaire de Manawan se penche sur la culture, le passé et la transmission du savoir et des connaissances au sein des membres d’une communauté atikamekw. Mu par le désir de renouer avec sa famille et ses racines, Tony Chachai livre un témoignage touchant sur le chemin qui l’a ramené auprès des siens. À l’aube de devenir père, il prend conscience de la richesse de cet héritage et célèbre ce passé en dansant dans un pow-wow aux côtés de son cousin.





 A travers les yeux de sa fille, Patpro va parcourir trois époques de l’histoire de son peuple indigène, au cœur de la forêt brésilienne. Inlassablement persécutés, mais guidés par leurs rites ancestraux, leur amour de la nature et leur combat pour préserver leur liberté, les Krahô n’ont de cesse d’inventer de nouvelles formes de résistance.
A travers les yeux de sa fille, Patpro va parcourir trois époques de l’histoire de son peuple indigène, au cœur de la forêt brésilienne. Inlassablement persécutés, mais guidés par leurs rites ancestraux, leur amour de la nature et leur combat pour préserver leur liberté, les Krahô n’ont de cesse d’inventer de nouvelles formes de résistance.












